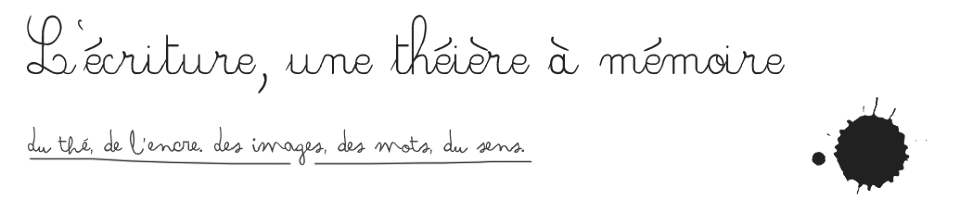Nuages épars de Mikio Naruse (1967)
« NUAGES. Sens et usage de l'assombrissement d'humeur
qui saisit le sujet amoureux au gré des circonstances variées. »(1)
qui saisit le sujet amoureux au gré des circonstances variées. »(1)
Est-il possible d'aimer l'être qui est à la source de notre plus grande peine, quand bien même il n'en n'est nullement tenu pour responsable ? Est-il en notre pouvoir d’accueillir celui qui a introduit la mort, qui a brisé l'élan vital et la foi dans l'éternité de tout instant de bonheur ? De manière plus générale, Nuages épars pose aussi ces autres questions : comment continuer à vivre dès lors que nous prenons conscience que tout bonheur est éphémère ? Est-il possible d'oublier complètement la mort ?
Nul ne maîtrise le ciel comme nul ne maîtrise sa destinée. Personne ne peut commander le temps qu'il va faire, mais chacun peut apprendre à vivre sous l'orage comme sous un ciel immaculé. Aucun nuage ne vient prédire le terrible destin qui frappe la vie paisible et heureuse de Yumiko et son mari. Ce dernier trouve la mort dans un accident de voiture brisant cette vie idyllique et anéantissant un avenir radieux déjà tout tracé. L'homme responsable de la mort de son mari, Shiro Mishima, est vite disculpé par la justice et le remord qui le ronge le pousse à aider Yumiko alors que tout, de son côté, la pousse elle, à fuir cet homme. Néanmoins, Shiro réussit, par le versement d'une pension afin de l'aider à vivre, à instaurer un premier lien avec Yumiko. Ce signe d'un premier attachement, qui ressemble à une correspondance blanche, sans mot, lie la victime à celui qui est à la source de son drame : en effet, aux yeux de Yumiko, Shiro ne peut être autre chose que la personnification de la fatalité, du malheur, de la mort.
Nul ne maîtrise le ciel comme nul ne maîtrise sa destinée. Personne ne peut commander le temps qu'il va faire, mais chacun peut apprendre à vivre sous l'orage comme sous un ciel immaculé. Aucun nuage ne vient prédire le terrible destin qui frappe la vie paisible et heureuse de Yumiko et son mari. Ce dernier trouve la mort dans un accident de voiture brisant cette vie idyllique et anéantissant un avenir radieux déjà tout tracé. L'homme responsable de la mort de son mari, Shiro Mishima, est vite disculpé par la justice et le remord qui le ronge le pousse à aider Yumiko alors que tout, de son côté, la pousse elle, à fuir cet homme. Néanmoins, Shiro réussit, par le versement d'une pension afin de l'aider à vivre, à instaurer un premier lien avec Yumiko. Ce signe d'un premier attachement, qui ressemble à une correspondance blanche, sans mot, lie la victime à celui qui est à la source de son drame : en effet, aux yeux de Yumiko, Shiro ne peut être autre chose que la personnification de la fatalité, du malheur, de la mort.
Yumiko freine toute marche en avant et choisit le retour en arrière, en revenant dans le village de son enfance. Le trajet en car est l'occasion pour elle de revivre ce passé heureux, et de revoir son mari en souvenir. Mikio Naruse utilise alors des images comme signifiant : la principale d'entre elles étant l'eau, et plus particulièrement à ce moment du film, une petite rivière, qu'elle aperçoit depuis la fenêtre du car, et qui est un moyen pour elle de convoquer le premier souvenir d'un bonheur paisible. Présent et passé sont mélangés sans qu'il n'y ait plus aucun avenir. Le retour à la ruralité signifie un retour aux sources, à la terre, à la simplicité. Les relations entre hommes et femmes y sont décomplexées comme ce couple que Yumiko surprend enlacé. Bien qu'elle tente d'oublier la vie dans la soumission au passé, les signes la poussent au contraire vers une pulsion de vie qu'elle cherche d'abord à étouffer.
Éros et Thanatos, pulsion de vie et pulsion de mort, dévorent Yumiko. La pulsion de vie se matérialise par le bonheur de construire une nouvelle vie avec cet homme exemplaire, tandis que la pulsion de mort lui rappelle que cet homme est aussi celui par qui tout peut s'arrêter brutalement. Mikio Naruse utilise alors un autre signifiant pour montrer ce combat intérieur : une tasse brisée. Alors qu'elle range la vaisselle, Yumiko laisse échapper une tasse et cette maladresse, cet acte inconscient, casse le cours tranquille de sa vie rangée et l'avertit que quelque chose se manifeste en elle au point de divertir son attention. Dans un second temps, un autre événement bouscule la vie paisible du village : un suicide dans le lac. Le remord, la culpabilité et la peur d'être elle aussi responsable de la mort d'autrui, la pousse à retrouver Shiro.
Tous deux prennent alors la route, en taxi, et ce timide et silencieux premier départ est coupé par un passage à niveau qui successivement montre un feu rouge, le passage interminable et assourdissant du train, et le regard accusateur du chauffeur dans le rétroviseur, autant de signes que Yumiko interprètent comme des condamnations de son choix. Un autre hasard vient porter un coup fatal à cet élan vital : ils seront témoins d'un accident de la route, l'incarnation mimétique de leur drame, trop lourd à porter pour Yumiko, qui anéantit définitivement sa pulsion de vie.
Après un dernier repas, et comme s'il comprenait que rien ne pouvait plus défaire les liens et les émotions opposés qui tissent une vie, et plus particulièrement la sienne et celle de Yumiko, Shiro entonne un chant glorifiant la récolte des fruits de la terre, que nourrissent les dons du ciel, contrastant avec le poids émotionnel de ce moment d'adieu.
Yumiko retrouve les berges du lac et cette dernière image du film figure à la fois l'impossibilité de prendre la route par cette masse d'eau qu'il faut traverser, le souvenir de son mari, le sommeil de la mort, dans lequel se reflète le ciel capricieux. Comme dans le poème de Lamartine, le lac symbolise ici, à la fois ce qui ne bouge pas et ce qui se renouvelle sans cesse. C'est l'image d'une réconciliation impossible : celle d'Éros et de Thanatos. Ou encore celle des temps passés et des temps à venir, celle des saisons. Le regard perdu dans l'horizon de ce plan d'eau, j'imagine Yumiko, tout bas, souffler ces quelques vers au silence retrouvé :
(1) Roland Barthes, Fragments d'un discours amoureux (1977). Et aussi : « Nuages... Ils sont aujourd'hui la réalité principale, et me préoccupent comme si le ciel se voilant était l'un des grands dangers qui menacent mon destin. (...) Nuages... J'existe sans le savoir, et je mourrai sans le vouloir. Je suis l'intervalle entre ce que je suis et ce que je ne suis pas, entre ce que je rêve et ce que la vie a fait de moi (...) » Fernando Pessoa, Le livre de l'intranquilité, 204, page 235, Christian Bourgois Éditeur, 1999. Texte écrit entre 1913 et 1935.
(2) Le Lac, poème tiré des Méditations poétiques (1820).
« Éternité, néant, passé, sombres abîmes,
Que faites-vous des jours que vous engloutissez ?
Parlez : nous rendrez-vous ces extases sublimes
Que vous nous ravissez ? »(2)
Que faites-vous des jours que vous engloutissez ?
Parlez : nous rendrez-vous ces extases sublimes
Que vous nous ravissez ? »(2)
(1) Roland Barthes, Fragments d'un discours amoureux (1977). Et aussi : « Nuages... Ils sont aujourd'hui la réalité principale, et me préoccupent comme si le ciel se voilant était l'un des grands dangers qui menacent mon destin. (...) Nuages... J'existe sans le savoir, et je mourrai sans le vouloir. Je suis l'intervalle entre ce que je suis et ce que je ne suis pas, entre ce que je rêve et ce que la vie a fait de moi (...) » Fernando Pessoa, Le livre de l'intranquilité, 204, page 235, Christian Bourgois Éditeur, 1999. Texte écrit entre 1913 et 1935.
(2) Le Lac, poème tiré des Méditations poétiques (1820).